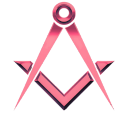Action sociale et franc-maçonnerie
Découvrez et contribuez au projet de recherche sur l’action sociale et franc-maçonnerie dans l’Ouest de la France, de 1748 à 1948. Une analyse historique inédite sur un engagement philanthropique méconnu.
Action sociale et franc-maçonnerie dans l’Ouest de la France
1748-1948
Présentation du projet de recherche
Action sociale et franc-maçonnerie : Avant propos de la rédaction du site franc-maconnerie-nantes.fr
Cette page a pour but d’aider un membre de notre association à travailler dans le cadre d’une thèse sur L’Action sociale et franc-maçonnerie. Un formulaire de contact est disponible en fin de présentation. Si vous pensez avoir des informations pertinentes à lui communiquer n’hésitez pas utiliser le formulaire de contact, le mail lui sera directement remis (pas d’intermédiaire).
Ce texte complet fait 5337 mots pour un temps de lecture estimé de 28 minutes.

Action sociale et franc-maçonnerie : Genèse du projet
Le Haut Conseil du travail social (H.C.T.S.), après un travail collectif de plusieurs mois, a donné, en février 2017, une définition du travail social qui a ensuite été reprise dans un décret du 6 mai 2017 :
« Le travail social est un ensemble de pratiques professionnelles qui s’inscrit dans un champ pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Il s’appuie sur des principes éthiques et déontologiques, sur des savoirs universitaires en sciences sociales et humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques des professionnels du travail social et les savoirs issus de l’expérience des personnes concernées, dans un processus de co-construction. Il se fonde sur la relation à l’autre, dans sa singularité et le respect de sa dignité. Il vise à permettre l’accès effectif de tous à l’ensemble des droits fondamentaux et à assurer la place de chacun dans la cité. Le travail social s’inscrit historiquement dans les valeurs républicaines, le respect des droits de l’Homme et du citoyen et la Constitution. Les principes de solidarité, de justice sociale, de laïcité, de responsabilité collective, et le respect des différences, des diversités, de l’altérité sont au cœur du travail social. Dans un but d’émancipation, d’accès à l’autonomie, de protection et de participation citoyenne, le travail social contribue à promouvoir, par des approches individuelles et collectives, la transformation sociale, le développement social, la cohésion de la société. Il participe au développement du pouvoir d’agir des personnes et des groupes dans leur environnement. En cohérence avec la définition internationale, et défini au niveau national, le travail social se décline sur les territoires dans le respect des principes généraux énoncés ».
Cette définition constitue, à mes yeux, un texte de référence important et ouvre, pour les années à venir, des perspectives significatives pour peu que les acteurs concernés sachent s’en emparer. Mais je dois aussi admettre, après 29 ans d’exercice professionnel dans l’action sociale, que celle-ci traverse – en particulier depuis l’ébranlement économique de 2008 – une véritable crise : raréfaction des ressources des associations, chute d’attractivité des métiers, faible reconnaissance des professionnels, difficultés croissantes en matière de recrutement en formation initiale, épuisement professionnel récurrent, abandons de carrière de plus en plus fréquents… A ce tableau déjà bien sombre, s’ajoutent la précarisation croissante de pans entiers de la population, les multiples configurations des situations de pauvreté, la tentation du « repli sur soi » et la montée des populismes. Autant de phénomènes qui pourraient se conjuguer pour menacer la nécessaire cohésion sociale au sein de nos sociétés. Face à cette évolution, les professionnels et responsables de l’action sociale ne peuvent que s’interroger, du moins ceux qui ont une haute idée de leur mission, ceux qui accordent encore quelque crédit aux valeurs humanistes et démocratiques qui ont enraciné l’évolution du travail social, ceux qui veulent vraiment faire en sorte que chacun puisse trouver une place dans la cité : est-il encore possible d’envisager une action sociale qui soit réellement protectrice des personnes, qui les accompagne sur le chemin de l’autonomie et soit respectueuse de ses valeurs fondatrices (droits de l’homme, respect des personnes…). Ne faut-il pas, dès à présent, envisager l’invention d’une nouvelle action sociale pour sortir de la pente actuelle – celle d’une action sociale « libérale » – et construire des réponses inédites face aux nouveaux problèmes sociaux ?
Une approche historique du travail social
Au terme de notre travail de définition qui a pour fonction de clarifier, autant que faire se peut, les termes utilisés dans notre réflexion sur le travail social, il nous paraît maintenant nécessaire d’élargir notre point de vue en allant interroger dans le champ du social – et la question sociale commence déjà à poindre – ce qui s’est défini peu à peu comme le travail social ou plutôt, pour reprendre une expression de Michel Chauvière, « le travail du social ». Une lecture historique du travail social s’impose donc pour tenter de comprendre le contexte des origines et beaucoup d’auteurs, à ce sujet, évoquent la fin du 19ème siècle et le début du 20ème siècle, une période particulièrement féconde sur le plan de la créativité sociale. Je pense à des auteurs tels que Henri Pascal (« Histoire du travail social en France. De la fin du XIXème siècle à nos jours », 2014), Christine Rater-Garcette (La professionnalisation du travail social. Action sociale, syndicalisme, formation. 1880-1920 » 1996), ou encore Sylvie Fayet-Scribe (Association féminines et catholicisme. De la charité à l’action sociale. XIXème – XXème siècle » 1990). Des auteurs qui insistent peu ou prou sur la nécessité de prendre en compte tous les facteurs qui ont contribué à l’émergence progressive de la question sociale (développement économique, théories politiques, évolution des idées, mouvement sociaux, féminisme…). Mais il ne faut pas oublier non plus que cette inventivité sociale vient d’encore plus loin. Et là, je pense à un auteur dont tout le monde a loué le travail de recherche, et je veux bien sûr citer Robert Castel : « Caractérisée par une inquiétude sur la capacité de maintenir la cohésion d’une société »,[11] la « question sociale » interroge en fait la capacité d’une société à exister comme un ensemble lié par des relations d’interdépendance. La transformation lente mais progressive de l’organisation de la société sous l’effet de la révolution industrielle, née en Angleterre dans les années 1770, prépare l’émergence de la question sociale. Pour Robert Castel, en effet, le XVIIIème siècle, et surtout sa seconde moitié, représente le moment où les « équilibres ancestraux se mettent à vaciller ».[2] Dans un pays, la France, où l’agriculture structure, et pour longtemps encore, les échanges dans un rayon géographique finalement assez limité, « une dynamique économique, commerciale et même industrielle de plus en plus insistante continue de se heurter à l’immobilité massive de l’ensemble de la société ».[3] Ce décalage entre la vision des promoteurs de la modernité, certes minoritaires, mais qui observent un certain nombre de transformations en train de s’opérer (accélération de la croissance démographique, développement progressif des échanges, croissance industrielle, naissance du machinisme…) et la réalité d’une société encore entravée par une organisation à leurs yeux dépassée, explique sans doute en partie les conflits à venir. Sous l’effet du processus d’industrialisation, qui détruit petit à petit mais lentement les sécurités antérieures, la question sociale se cristallise sur celle de la pauvreté. Pour Alban de Villeneuve-Bargemont, en effet, « le paupérisme est une menace à l’ordre politique et social ».[4] Louis-Napoléon Bonaparte, quant à lui, dans un pays qui reste, on l’a dit, majoritairement agricole, précise sa vision de l’industrie :
« cette source de richesses » qui « n’a aujourd’hui ni règle, ni organisation, ni but. C’est une machine qui fonctionne sans régulateur ; peu lui importe la force motrice qui l’emploie. Broyant également dans ses rouages les hommes comme la matière, elle dépeuple les campagnes, agglomère la population dans des espaces sans air, affaiblit l’esprit comme le corps, et jette ensuite sur le pavé, quand elle ne sait plus qu’en faire, les hommes qui ont sacrifié pour l’enrichir leur force, leur jeunesse, leur existence. Véritable Saturne du travail, l’industrie dévore ses enfants et ne vit que de leur mort ».[5]
Un peu plus tard, en 1865, Emile Laurent, par sa description de la pauvreté, insiste sur le caractère inédit de la situation :
« La misère et la subversion de l’intelligence, la pauvreté et l’abaissement de l’âme, l’affaiblissement et la décomposition de la volonté et de l’énergie, la torpeur de la conscience et de la personnalité, l’élément moral en un mot, sensiblement, souvent même mortellement atteint. Voilà le caractère essentiel, fondamental et absolument nouveau du paupérisme ».[6]
Mais avant de détailler davantage ce qui se passe sur la période 1880-1920, il nous faut revenir sur la thèse de Jacques Donzelot, pour qui « la révolution de 1848 constitue pour la République une inauguration en forme de traumatisme initial ».[7] Pour l’auteur, en effet, « si donc l’on veut comprendre pourquoi il faut dans notre société “ faire du social ”, c’est d’abord à cet événement qu’il faut se rapporter, à ce moment où le social apparaît comme une question qui ouvre l’histoire réelle de la République après qu’elle eut perdu les prestiges de la virtualité ».[8] L’effacement des promesses et certitudes contenues dans l’idéal républicain fragilise le fondement du pouvoir politique et la question sociale doit, par conséquent, être définie autrement. Il s’agit alors de se demander « comment réduire cet écart entre le nouveau fondement de l’ordre politique et la réalité de l’ordre social, afin d’assurer la crédibilité du premier et la stabilité du second, si l’on ne veut pas que le pouvoir républicain soit à nouveau investi d’espérances démesurées, puis victime aussitôt du désenchantement destructeur de ceux-là mêmes qui devraient lui être le plus attachés ? »[9] En définitive, la question qui se pose, c’est de « trouver un compromis entre le marché et le travail qui assure la paix sociale et résorbe la désaffiliation de masse créée par l’industrialisation. »[10] Il va donc falloir résoudre la question ouvrière. Pour cela les « bonnes raisons » ne manquent pas, qu’il s’agisse de contenir la classe ouvrière considérée comme dangereuse pour l’ordre établi, c’est-à-dire faire du social pour l’arracher aux sirènes du socialisme ou, au contraire, qu’il s’agisse d’œuvrer à son émancipation pour lui permettre d’échapper au processus d’exploitation dont elle est l’objet…
Action sociale et franc-maçonnerie
Progressivement, le terrain se prépare et devient favorable à l’émergence d’une multitude d’initiatives sur le plan de l’action sociale, qu’elles soient d’origine privée ou publique. Dans son ouvrage intitulé La professionnalisation du travail social, évoqué plus haut, Christine Rater-Garcette défend deux thèses, la première étant que « la Séparation des Eglises et de l’Etat intervenue en 1905 doit être considérée comme l’événement déclencheur qui fait accéder des femmes habitées par l’apologétique sociale du catholicisme à la nécessité d’une action sociale procéduralement différente, plus technique et plus professionnelle ».[11] La deuxième thèse, quant à elle, met en avant l’idée que le syndicalisme féminin fournit une sorte de « matrice transitionnelle » pour cette mutation historique, tant en « ce qui concerne la lecture de la question sociale que la conception de la socialisation au métier ». Avant d’illustrer plus concrètement ces deux thèses, il nous faut revenir quelques instants sur un texte majeur qui pose la doctrine sociale de l’Eglise pour plusieurs années, et sert de référence justificative à l’action sociale engagée par beaucoup de précurseurs. Nous voulons naturellement parler de la lettre encyclique Rerum Novarum, publiée le 15 mai 1891 par le pape Léon XIII, qui traite de la « Condition des ouvriers ». Cette question taraude tous les esprits et le pape y revient en préambule de sa « lettre », dramatisant le contexte de l’époque.
Pour Léon XIII, en effet, « partout, les esprits sont en suspens et dans une anxieuse attente, ce qui seul suffit à prouver combien de graves intérêts sont ici engagés. Cette situation préoccupe à la fois le génie des savants, la prudence des sages, les délibérations des réunions populaires, la perspicacité des législateurs et les conseils des gouvernants. En ce moment, il n’est pas de question qui tourmente davantage l’esprit humain ».[12] Le pape, écartant d’emblée, et avec vigueur, les solutions chimériques prônées par les socialistes qui « poussent à la haine jalouse des pauvres contre les riches », convient néanmoins « qu’il faut, par des mesures promptes et efficaces, venir en aide aux hommes des classes inférieures, attendu qu’ils sont pour la plupart dans une situation d’infortune et de misère imméritées ». Affirmant « en toute vérité que le travail est le moyen universel de pourvoir aux besoins de la vie », le pape insiste aussi sur le rôle éminent de la famille, « société domestique, société très petite sans doute, mais réelle et antérieure à toute société civile ». Il ajoute que ce serait « une erreur grave et funeste de vouloir que le pouvoir civil pénètre à sa guise jusque dans le sanctuaire de la famille ». Si le pape demande aux hommes d’accepter comme une nécessité de la nature la différence de leurs conditions respectives, il rappelle aussi le rôle premier de l’Eglise qui « par une foule d’institutions éminemment bienfaisantes, tend à améliorer le sort des classes pauvres ». Il prône l’équilibre harmonieux entre les classes, souligne que :
« les patrons et les ouvriers eux-mêmes peuvent singulièrement aider à la solution de la question par toutes les œuvres propres à soulager efficacement l’indigence et à opérer un rapprochement entre les deux classes ».
Il évoque également le travail des femmes et des enfants, la question du salaire des ouvriers et insiste enfin sur la nécessité du perfectionnement moral et religieux.
Pour conclure cette longue partie sur les origines de la professionnalisation du travail social, il n’est pas inutile de pointer les convergences qui caractérisent les acteurs de l’époque : ces derniers veulent se démarquer de ceux qui font du social à un titre ou à un autre. Ils veulent aussi définir de façon précise l’action sociale qu’ils entendent mener, insistent sur l’importance de la formation qui permet de « faire du social » en professionnel et pas seulement en « dame d’œuvre charitable » et ils ont le souci de démontrer enfin que l’action sociale va bien au-delà de l’aide individualisée pour s’inscrire dans une démarche collective qui vise à agir sur la société. Ce détour historique n’a pas pour objectif de porter au pinacle un passé idyllique, mais bien au contraire de faire prendre conscience de « l’héritage » qui est le nôtre. Car le travail social contemporain s’est construit sur ces bases et il n’est même pas interdit de penser qu’il est possible de mettre au jour un certain nombre de similitudes entre la situation économique et sociale de l’époque et celle d’aujourd’hui. Nous avons fait nôtre, pour ce travail de recherche historique, la citation de Fernand Braudel proposée par Robert Castel. L’historien aimerait
« que les spécialistes des sciences sociales voient pareillement dans l’histoire un moyen de connaissance et de recherche. Le présent n’est-il pas plus qu’à moitié la proie d’un passé obstiné à survivre, et le passé, par ses règles, ses différences et ses ressemblances, la clef indispensable de toute connaissance du présent ? »[13]
Action sociale et franc-maçonnerie : Pourquoi se pencher vers le XIXème siècle ?
Une question a été posée plus haut, au terme de la genèse du projet : « Ne faut-il pas, dès à présent, envisager l’invention d’une nouvelle action sociale pour sortir de la pente actuelle et construire des réponses inédites face aux nouveaux problèmes sociaux ? ». Si une réponse affirmative est apportée à cette question, peut-être faut-il, en quelque sorte, retourner en arrière et refaire le cheminement vers la « source », aller fouiller du côté du berceau de l’action sociale « moderne », autrement dit, se plonger dans le XIXème siècle ? Peut-être pourrions-nous alors y déceler des pistes de travail oubliées !
L’approche historique qui vient d’être présentée, sans doute très incomplète, met en évidence quatre lignes de force qui me semblent caractériser cette histoire de l’action sociale : l’énergie et l’engagement des acteurs pour tenter de résoudre les problèmes sociaux (avec parfois des arrière-pensées !), la volonté de construire une action sociale « professionnelle », la prééminence du « christianisme social », la conception du progrès comme source d’amélioration de la condition humaine.
Mais cette « histoire officielle », écrasante parfois, ne masque-t-elle pas des zones d’ombre inexplorées, des oublis fâcheux, des pistes à exhumer et, pour reprendre les travaux de l’historienne Michèle Riot-Sarcey, des idées à reprendre, incomprises à l’époque car minoritaires et utopiques, « maltraitées par l’histoire devenue canonique » ? N’y a-t-il pas, en définitive, une « autre histoire » à écrire sur ce « siècle des possibles » (Emmanuel Fureix), d’autres lignes de force à faire jaillir, d’autres acteurs à réhabiliter ?
Il me semble que les francs-maçons relèvent de ces « minorités agissantes » qui, dans l’histoire et parfois sous les huées, ont apporté, par leurs réflexions individuelles ou collectives, par leur dispositif original de production d’idées, mais aussi par leurs réalisations concrètes, une contribution éminente à la fabrication des sociétés de leur temps, tournées vers un progrès émancipateur. Les quelques exemples qui suivent, puisés dans mes lectures, semblent valider cette approche :
Action sociale et franc-maçonnerie :
André Combes, dans son Histoire de la franc-maçonnerie au XIXème siècle, souligne ainsi, pendant la période 1862-1870, l’ouverture des loges aux problèmes de la cité et leur attention aux plus défavorisés. Il ajoute aussi que le thème de la misère n’est pas absent des travaux des loges de la décennie 1872-1882. Il cite également, parmi les œuvres maçonniques à vocation sociale, « le Foyer fraternel »…
Pierre Chevallier, dans son Histoire de la Franc-Maçonnerie française (tome 3), rappelle que « dès l’été de 1870, le Grand-Maître Babaud-Laribière invitait les Loges à étudier les questions sociales » et souligne, face à l’indifférence de l’Etat, l’engagement des frères dans les sociétés de bienfaisance.
Eric Saunier, dans L’Encyclopédie de la franc-maçonnerie qu’il a dirigée, met également en évidence le rôle joué par des francs-maçons et francs-maçonnes en matière d’action sociale et de philanthropie, la diversité des sujets de réflexion traités et des actions concrètes mises en œuvre : Marie Bequet de Vienne (en faveur de l’allaitement maternel), Antoine Blatin (solidarité sociale et assistance publique intégrale), Francisco Ferrer Guardia (éducation), Alphonse de Lamartine (discours sur les enfants trouvés), Louis-François de la Tierce (création d’une fondation charitable), Louis-Adrien Lucipia (réforme de l’assistance publique relativement aux filles-mères…), Jean Macé (éducation et formation des jeunes citoyens), Benoît Malon (propositions de réformes sociales), Alexis Parementer (l’œuvre maçonnique du travail, groupe d’entraide des maçons chômeurs), Georges Martin (organisation de l’assistance médicale dans les campagnes, inspection médicale dans les écoles, droits des femmes…), Louis Camus de Pontcorré (Société Philanthropique, pour substituer à la charité traditionnelle une action fondée sur l’utilité sociale des indigents), Camille Charvet (DH, sensibilité aux questions sociales), Charles Debierre (les maladies du corps social), Maria Deraismes (droits de l’enfant), Louise Michel…
Un autre auteur, enfin, mérite amplement d’être également cité pour avoir aussi travaillé spécifiquement sur la question qui m’occupe. En effet, Paul Gourdot, ancien Grand Maître du Grand Orient de France (GODF), dans son ouvrage paru en 1999 et intitulé Le Combat social des Francs-Maçons, rappelle, dans son avant-propos, que pour la Franc-Maçonnerie libérale, « la Franc-Maçonnerie est un combat libérateur ».[14] Un peu plus loin, dans un Avis au lecteur, après avoir circonscrit sa démarche de recherche entre 1777 et 1877, il en précise le projet pour souligner son désir de retracer « l’histoire du Grand Orient de France sous son aspect d’évolution vers une structure à vocation sociale »,[15] mais aussi de montrer comment, à partir de ses réalisations, cette structure, « pratiquant la philanthropie pour ses membres, puis une philanthropie généralisée, en arrive à la conception utopiste du bonheur des hommes qu’il faut construire plus généralement par la voie sociale, laissant à chacun la porte ouverte de la construction de son bonheur individuel par la voie divine ».[16] On pressent déjà, à travers ces quelques lignes, comment l’héritage des Lumières a pu pénétrer la franc-maçonnerie et opérer progressivement – avec des avancées et des reculs souvent liés à l’évolution politique – son œuvre d’émancipation, comment aussi la franc-maçonnerie et les francs-maçons ont pu évoluer pour élargir leur approche vers une visée de plus en plus universelle, passant de la charité à la philanthropie, puis à l’action sociale pensée et organisée. Une visée universelle dont il est d’ailleurs possible d’identifier les prémices dans le discours prononcé en 1740 par Louis de Pardaillan de Gondrin, duc d’Antin (1707-1743) et dans lequel il affirme déjà que « les hommes ne sont pas distingués essentiellement par la différence des langues qu’ils parlent, des habits qu’ils portent, des pays qu’ils occupent, ni des dignités dont ils sont revêtus », ajoutant aussitôt que « le monde entier n’est qu’une grande république, dont chaque nation est une famille et chaque particulier un enfant ».[17] Nombreux, en réalité, sont les textes qui permettent d’affirmer, avant et après la Révolution française, les préoccupations altruistes de la franc-maçonnerie, sa volonté également de se placer « à l’avant-garde du progrès ».[18] La Révolution de 1830 semble marquer un tournant dans l’action sociale et franc-maçonnerie. Paul Gourdot cite ainsi un extrait du discours du F. Jay, prononcé le 16 octobre 1830 à l’occasion de la Fête nationale et maçonnique célébrée par le GODF, repris dans la revue L’Abeille Maçonnique du 6 décembre 1830 : « De grandes questions sont soulevées ; il s’agit de l’amélioration progressive de l’homme en société. Voilà quel doit être le but de nos méditations, le constant objet de nos travaux. Pendant que le siècle avance, la maçonnerie ne peut rester en repos ».[19] Progressivement, commence à se dessiner un projet social influencé par l’utopie sociale, mais aussi le saint-simonisme, qui « s’inscrit dans une vision prospective du destin de l’humanité, dans laquelle la Maçonnerie est le trait d’union entre les générations ».[20] Une œuvre sociale maçonnique qui reposerait, selon certains frères, sur deux pivots principaux : l’Instruction et la Bienfaisance, une « bienfaisance qui dépasserait le cadre de la simple charité et que nous qualifierions de nos jours d’action sociale ».[21]
Petit à petit, se construit progressivement unefranc-maçonnerie désireuse de s’élever mais aussi d’aller au-delà de la seule distribution du denier de la Veuve, une franc-maçonnerie ancrée dans une action concrète qui ne se limite pas à l’enceinte de la loge (Propositions de la loge La Clémente Amitié : extinction de la mendicité, amélioration des hôpitaux et des monts de piété, fondation de maisons de travail et de refuge, de caisses d’épargne et de prévoyance…). Un texte de décembre 1847, publié dans la revue La Fraternité Maçonnique, situe bien l’état d’esprit de l’époque et résonne aujourd’hui d’une étonnante actualité lorsqu’il affirme que la « Maçonnerie doit marcher avec le temps ; prendre le caractère de la société dans laquelle elle se trouve, se modifier sans cesse… ».[22] Progressivement, les questions liées à l’éducation (La Fraternité, février 1848), à l’esclavage, mais aussi à l’organisation du travail (De l’organisation du travail, par Jules Lavoine, in Le Franc-Maçon, n° 1, juin 1848), vont se placer au cœur des réflexions des Francs-Maçons. Si l’activité maçonnique est intense de 1865 à 1870, ce n’est pas encore assez pour Léonide Babaud-Laribière, orateur officiel du GODF qui, dans un discours de 1869, invite les francs-maçons à élargir leur champ d’intervention : « … L’instruction est-elle assez répandue, les principes de l’association sont-ils bien définis et bien compris, la bienfaisance, l’enseignement supérieur, les bibliothèques, l’organisation des retraites, l’assurance, la mutualité, ne sont-ce pas autant de sujets qui appellent nos méditations, que nous pouvons expérimenter chez nous d’abord, pour les répandre ensuite dans le monde ? ».[23] Tout un programme ! La nouvelle définition de l’article 1er de la Constitution du GODF illustre l’évolution de cette institution qui, certes, se libère de la référence à Dieu, mais souligne aussi l’importance de « l’exercice de la Bienfaisance » et affirme « la Solidarité humaine » comme principe essentiel avec « la Liberté absolue de conscience ». La « cohabitation » des deux termes « bienfaisance » et « solidarité » au cœur de cet article 1er de la Constitution peut être lu comme à la fois la prise en compte de « l’héritage social » de la franc-maçonnerie, fondé sur la notion de bienfaisance qui a traversé des dizaines d’années de pratique sociale, mais annonce aussi, avec le mot « solidarité », une autre approche de l’action sociale, plus organisée et plus collective, tant au sein du GODF d’ailleurs que des structures de l’Etat. Une action sociale maçonnique plus ambitieuse, inscrite dans la société de son temps et qui fasse « œuvre d’utilité publique », comme en témoigne cet extrait du Bulletin du Grand Orient (BGO) de novembre 1863 : « Certes, œuvre maçonnique ne doit pas être confondue avec les œuvres de Charité et de Secours mutuels. La Maçonnerie est mieux que cela, et son œuvre est plus haute. Institution d’ordre moral, association universelle, elle embrasse l’Etre humain sous tous ses aspects, veut le bonheur, la lumière et le progrès pour tous, et professe que rien de ce qui intéresse l’humanité ne lui est étranger ».[24]
Si les lignes qui précèdent m’ont permis de tracer à gros traits l’évolution de la franc-maçonnerie en matière d’action sociale, du moins celle du GODF, à partir de la fin du 18ème siècle jusqu’à la fin du 19ème siècle, elles ne disent rien, en revanche, de ses réalisations concrètes dont un bref aperçu va maintenant être présenté, un aperçu qui n’a nulle prétention à l’exhaustivité.
| Nature des actions action sociale et franc-maçonnerie | Ville | Sources |
| Aide aux familles d’ouvriers et aux veuves | Bordeaux, Marseille, Rouen, Toul, Mulhouse, Le Havre | Paul Gourdot, FMM[25] n° 17 (Bordeaux) |
| Service médical, hygiène, prévention | Bordeaux, Marseille, Rouen, Toul, Mulhouse, Le Havre, Lyon | Paul Gourdot, FMM n° 18 (Lyon) |
| Service d’apprentissage | Bordeaux, Marseille, Rouen, Toul, Mulhouse, Le Havre | Paul Gourdot |
| Bureau de placement | Bordeaux, Marseille, Rouen, Toul, Mulhouse, Le Havre | Paul Gourdot |
| Maternelle pour enfants d’ouvriers | Bordeaux, Marseille, Rouen, Toul, Mulhouse, Le Havre | Paul Gourdot |
| Ramassage et distribution de vieux vêtements | Bordeaux, Marseille, Rouen, Toul, Mulhouse, Le Havre | Paul Gourdot |
| Enseignement professionnel des jeunes filles | Bordeaux, Marseille, Rouen, Toul, Mulhouse, Le Havre | Paul Gourdot |
| Secours à domicile | Rouen | Paul Gourdot |
| Récompenses maçonniques | Rouen | Paul Gourdot |
| Asiles pour enfants pauvres | Rouen | Paul Gourdot |
| Crèches maçonniques et orphelinats | Rouen, Bordeaux, Douai | Paul Gourdot, CHM[26] n° 78 |
| Soupes populaires | Paris, Nîmes | Paul Gourdot |
| Education Patronages laïques, Sou des écoles, cours du soir, caisses des écoles (Charles Floquet), écoles primaires mixtes, écoles d’adultes | Lyon, Strasbourg, Nice… | Paul Gourdot, CHM n° 74, FMM n° 18 (Lyon), FMM n° 21 (Strasbourg), FMM n° 25 (Nice) |
| Bibliothèques populaires | CHM n° 74 | |
| Actions en faveur des indigents | Lyon | FMM n° 18 |
| Droits de L’Homme | Lyon | FMM n° 18 (Bertholon et Charassin), Histoire de la FM à Lyon des origines à nos jours (André Combes) |
| Patronage pour enfants | Lyon | FMM n° 18, Mémoire du cent-cinquantenaire (1840-1990). |
| Ecole de sages-femmes | Lyon | FMM n° 18 (Emmanuel Gilibert) |
| Logement social | Limoges | FMM n° 38 |
| Colonies de vacances | St Nazaire | Patronage Maçonnique |
| Prévention sanitaire | Rennes (Oscar Leroux) | Biographie d’Oscar Leroux |
| Médecine | Morlaix (Bouëstard) | Biographie de Bouëstard |
| Médecine | Lorient (Louis Bodélio) | Biographie de Bodelio |
A travers ces quelques exemples (il y en a bien d’autres !), on voit bien que les francs-maçons n’ont jamais véritablement été absents face aux problèmes sociaux !
C’est ce travail de recherche que je souhaiterais entreprendre : mettre au jour la pensée et les réalisations de la franc-maçonnerie en matière d’action sociale, qu’il s’agisse des obédiences et des loges concernées, mais aussi des francs-maçons eux-mêmes (sans oublier bien sûr les francs-maçonnes, très actives également dans l’action sociale !).
Et puis aussi – mais ceci est sans doute utopique – essayer de comprendre ce qui a pu être le moteur de l’action de ces hommes et de ces femmes, essayer d’identifier ce qui a motivé leur engagement en faveur des plus démunis, les valeurs sur lesquelles ils ont appuyé leur action, bref, de quoi alimenter peut-être la réflexion sur l’action sociale actuelle et son devenir.
Si la période de recherche envisagée porte sur le XIXème siècle – à cause de ses potentialités émergentes et de l’énergie de ses acteurs – je n’écarte pas l’idée de pousser aussi mon travail sur le début du XXème siècle, une période également très « créative » pour l’action sociale et franc-maçonnerie, sans oublier les prémices contenues dans le XVIIIème siècle.
Problématique : Action sociale et franc-maçonnerie
A ce stade de ma réflexion et compte tenu des connaissances limitées dont je dispose, j’envisage de porter mon effort dans trois directions :
- Essayer d’identifier le contenu et les caractéristiques de la « pensée maçonnique » en matière d’action sociale à partir des sources disponibles (sous réserve qu’il y en ait !) au niveau des obédiences et des loges.
- Essayer d’identifier le contenu et les caractéristiques des pratiques opératives des obédiences et des loges en matière d’action sociale.
- Mettre au jour des francs-maçonnes et francs-maçons particulièrement actifs en matière d’action sociale.
Mais, dans l’immédiat et dans le cadre de ce master, il me faut revoir bien sûr cette ambition « à la baisse » et « resserrer » mon objet de recherche. Autrement dit – et c’est l’une des pistes que j’envisage de retenir – appliquer les trois directions de travail citées à l’instant sur une région, la Bretagne, par exemple.
Dans un premier temps, sous réserve d’archives suffisantes, peut-être serait-il possible, à partir du schéma qui suit, de faire un premier travail prospectif pour identifier les acteurs importants, les actions particulièrement significatives et les textes de référence, susceptibles d’éclairer une pensée sociale en émergence :
| Thématique | Nantes | Rennes | St Nazaire | Morlaix | Brest | Lorient | Quimper | … |
| Enfance Famille | ||||||||
| Médecine | ||||||||
| Travail | ||||||||
| Education | ||||||||
| Pauvreté | ||||||||
| Logement | ||||||||
| Droits |
Au terme de cette recherche exploratoire qui s’appuiera sur des lectures, sur la consultation d’archives, mais aussi la mobilisation des loges concernées, il sera nécessaire, en fonction de la qualité du matériau obtenu, de choisir, pour l’approfondir, une piste de travail parmi celles qui auront pu être identifiées : creuser une seule thématique sur l’ensemble des villes retenues, creuser une thématique dominante par ville…
Sources possibles pour Action sociale et franc-maçonnerie
Les sources sur lesquelles je pourrais m’appuyer sont les suivantes : fonds d’archives du Grand Orient de France, fonds maçonnique de la Bibliothèque Nationale de France, archives municipales et départementales, revues maçonniques…
Action sociale et franc-maçonnerie : contribuez si vous avez des éléments :
Bibliographie
Les ouvrages sur lesquels je souhaite notamment m’appuyer pour réaliser ce travail de recherche sur action sociale et franc-maçonnerie porteront à la fois sur les ouvrages qui traitent de la franc-maçonnerie dans les villes concernées, mais aussi ceux qui me permettront de mieux comprendre le contexte social local.
A titre indicatif et sans exhaustivité, voici quelques ouvrages qui ressortissent de ces catégories :
APRILE Sylvie, 1815-1870 : La Révolution inachevée, Paris, Editions Belin, 2014, 670 p.
BRENGUES Jacques, Les Francs-Maçons dans la ville, Saint-Brieuc, 1760-1990, Rennes, Editions Soreda, 1995, 237 p.
BRODIEZ-DOLINO, Combattre la pauvreté. Vulnérabilités sociales et sanitaires de 1800 à nos jours, CNRS Edition, 2013, 328 p.
CHEVALLIER Pierre, Histoire de la Franc-Maçonnerie française, Editions Fayard, volume 1, 1974, volume 2, 1974, volume 3, 1975, 1443 p.
COMBES André, Histoire de la Franc-Maçonnerie au XIXe siècle, Monaco, Editions du Rocher, volume 1, 1998, volume 2, 1999, 884 p.
DUPRAT Catherine, Usage et pratiques de la philanthropie. Pauvreté, action sociale et lien social, à Paris, au cours du premier XIXe siècle, Paris, Comité d’histoire de la sécurité sociale, volume 1, 1996, volume 2, 1997, 1393 p.
FUREIX Emmanuel, Le Siècle des Possibles, 1814-1914, Presses Universitaires de France, 2014, 240 p.
GUENGANT Jean-Yves, Brest et la Franc-Maçonnerie, Brest, Editions Armeline, 2008, 474 p.
GOURDOT Paul, Le Combat social des Francs-Maçons, Paris : Editions du Rocher, 1999, 302 p.
KERJAN Daniel, Rennes : les francs-maçons du Grand Orient de France, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005, 357 p.
MAREC Yannick, Pauvres et philanthropes à Rouen au XIXe siècle, CRDP, Rouen, 1981, 135 p.
MAREC Yannick (en co-direction), Le social dans la ville en France et en Europe, (1750-1914), Paris, Les Editions de l’Atelier, 1996, 351 p.
MAREC Yannick, Bienfaisance communale et protection sociale à Rouen (1796-1927), Paris, La Documentation Française, 2 volumes, 2002, 1362 p.
MAREC Yannick, Pauvreté et protection sociale au XIXe et XXe siècles, Presses Universitaires de Rennes, 2006, 404 p.
RIOT-SARCEY Michèle, Le procès de la liberté. Une histoire souterraine du XIXe siècle en France, Paris, Editions La Découverte, 2016, 355 p.
ROME Yannic, 1744-2006, La Franc-maçonnerie en Morbihan, Le Faouët, Liv’Editions, 2006, 250 p.
ROME Yannic, 25 ans de Franc-Maçonnerie en Bretagne, Le Faouët, Liv’Editions, 1997, 331 p.
SAUNIER Eric, Révolution et sociabilité en Normandie au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, Rouen, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 1998, 555 p.
SAUNIER Eric (sous la direction de), Encyclopédie de la Franc-Maçonnerie, Le Livre de Poche, 2000, 982 p.
Revue d’histoire du XIXe siècle.
MORLAT Patrice, La République des frères, Le Grand Orient de France de 1870 à 1940, Editions Perrin, 2019, 848 p.
Bibliographie du texte Action sociale et Franc-maçonnerie
- Castel Robert, Les métamorphoses de la question sociale, Paris : Folio Essais, 1999, p. 39. ↩︎
- Castel Robert, ibid, p. 327. ↩︎
- Castel Robert, ibid, p. 328. [1] Villeneuve-Bargemont Alban de, Traité d’économie politique chrétienne ou recherches sur le paupérisme, Paris : 1834. Cité par Robert Castel, ibid, p. 351. ↩︎
- Villeneuve-Bargemont Alban de, Traité d’économie politique chrétienne ou recherches sur le paupérisme, Paris : 1834. Cité par Robert Castel, ibid, p. 351. ↩︎
- Bonaparte Louis-Napoléon, « L’Extinction du paupérisme », in Œuvres, Paris : Editions napoléoniennes, édition de 1848. Cité par Robert Castel, ibid, p. 352. ↩︎
- Laurent Emile, Le Paupérisme et les institutions de prévoyance, Paris : 1865. Cité par Robert Castel, ibid, p. 355. ↩︎
- Donzelot Jacques, L’invention du social, Paris : Points Essais, 1994, p. 20. ↩︎
- Donzelot Jacques, ibid, p. 20. ↩︎
- Donzelot Jacques, ibid, p. 33. ↩︎
- Castel Robert, ibid, p. 342. ↩︎
- Rater-Garcette Christine, ibid, p. 12, (préface de Michel Chauvière) ↩︎
- www.ssf-fr.org ↩︎
- Castel Robert, ibid, p. 11. ↩︎
- GOURDOT Paul, Le Combat social des Francs-Maçons, Paris : Editions du Rocher, 1999, p. 15. ↩︎
- GOURDOT Paul, ibid, p. 19. ↩︎
- GOURDOT Paul, ibid, p. 19. ↩︎
- « La Franc-Maçonnerie au XVIIIe », par le F. Louis Amiable, in La Franc-Maçonnerie en France depuis 1725, discours du 16 juillet 1889, séance du Congrès Maçonnique International, p. 11. ↩︎
- GOURDOT Paul, ibid, p. 44. ↩︎
- GOURDOT Paul, ibid, p. 64. ↩︎
- GOURDOT Paul, ibid, p. 65. ↩︎
- GOURDOT Paul, ibid, p. 69. ↩︎
- GOURDOT Paul, ibid, p. 73. ↩︎
- Gourdot Paul, ibid, p. 90. « Discours de Babaud-Laribière, orateur officiel », in Le Monde Maçonnique, juillet 1869, p. 170-171. ↩︎
- Gourdot Paul, ibid, p. 111, BGO, novembre 1863, n° 9. ↩︎
- Franc-Maçonnerie Magazine ↩︎
- CHM : Chroniques d’Histoire Maçonnique ↩︎